
Les militants amérindiens mènent une campagne visant à intégrer les connaissances écologiques traditionnelles dans les décisions de gestion des terres
Illustration de Glenn Harvey Chaque fois que je vois un autocollant de pare-chocs indiquant « Décoloniser la terre » ou « Ramatrier la terre » ou, simplement, « Land Back », je ressens un petit élan de fierté et d’excitation. Après tout, peu de choses sont plus importantes pour les peuples autochtones que la restitution des terres ancestrales volées. Il ne s’agit cependant pas de simples slogans ; ces mots représentent des valeurs, des aspirations et des modes de vie importants parmi les peuples autochtones. Ils nous rappellent comment les terres autochtones du monde entier, y compris ici aux États-Unis, ont été colonisées. Cette colonisation se poursuit aujourd’hui sous la forme de l’exploitation forestière, de l’exploitation minière et du forage pétrolier et gazier – des processus de pillage appelés par euphémisme « extraction de ressources » ou « développement économique ». Mais il existe également de puissants contre-mouvements contre cette colonisation continue, des efforts visant à restaurer les terres et les eaux sous la tutelle et/ou l’intendance autochtone. Ces mouvements cherchent à restituer la terre à la Mère originelle et aux mères de nos cultures pour entamer le processus de réparation, de guérison et de rétablissement. Comme le dit la militante et auteure anishinaabe Winona LaDuke : « La seule compensation pour la terre, c’est la terre ».
Nous, les peuples autochtones, avons l’obligation culturelle et spirituelle d’incarner les idéaux autochtones d’interrelations et de rétablir l’équilibre entre les personnes et le lieu. Il s’agit bien sûr d’un énorme défi dans un pays axé sur l’individualisme et le matérialisme, un pays qui porte l’héritage brutal du colonialisme de peuplement. Décoloniser, c’est reconstruire quelque chose, rassembler les fragments et les éclats qui ont été brisés par les armes coloniales et les cartes impérialistes, ainsi que supprimer les autres frontières de division qui cherchent à séparer, supprimer, enfermer, contrôler et – si elles sont incontrôlables – détruire au nom de l’empire et du capital, ou même de Dieu. Décoloniser, c’est déconstruire la vision capitaliste du monde qui marchandise la terre et les processus de vie. Décoloniser, c’est ré-autochtoniser les valeurs et les pratiques de relations réciproques dans lesquelles la connexion communautaire est la clé de la résilience.
Si l’on essaie de traduire le mot atterrir ou eau dans différentes langues autochtones, on découvre vite que les mots pour décrire ces choses décrivent en réalité des processus. Dans de nombreuses langues autochtones, ces entités ressemblent davantage à des verbes qu’à des noms, des expressions qui mettent l’accent sur les flux dynamiques des relations et des cycles d’affirmation de la vie. Par exemple, le militant hawaïen Mark Paikuli-Stride définit le mot aina» – un mot généralement traduit pour signifier « terre » – par « ce qui vous nourrit ». En ce sens, la terre n’est pas seulement un bout de terre mais un être liée aux cosmologies d’appartenance et de liens généalogiques, une entité d’où émergent les aliments sacrés de la terre et de la mer. De même, le botaniste Robin Kimmerer partage que le mot Potawatomi pour une baie, Wiikwegama, est en fait un verbe qui signifie « être une baie », puisqu’il s’agit d’un être animé. La terre et l’eau ne sont pas des choses, des noms ou des marchandises. Ce ne sont même pas des ressources naturelles. Ce sont des processus vivants, des flux d’énergie et de matière en mouvement au-delà des frontières perçues, comme l’animation et l’unité de l’eau dans nos corps, dans les plantes, dans les rivières et dans les océans.
Il semble que de nombreuses personnes, de tous horizons et de tous horizons, ont soif de redéfinir nos relations avec le monde vivant – de passer d’une vision de la terre comme une propriété privée disponible pour l’exploitation et l’extraction à une compréhension de la terre comme un flux et une nourriture. Comment pouvons-nous revenir, d’une manière fraîchement imaginée, à une nouvelle compréhension de la terre comme de la nourriture ? À quoi cela ressemblerait-il de transformer ces slogans d’autocollants en programmes et politiques de décolonisation ? Pour commencer, nous devons changer la manière dont les terres dites publiques aux États-Unis sont gouvernées ainsi que la manière dont elles sont gérées.
Nous pouvons considérer le monument national Bears Ears, dans le sud de l’Utah – créé par le président Obama, réduit par le président Trump et, espérons-le, bientôt restauré par le président Biden – comme un exemple frappant de ce à quoi cela ressemble lorsque les nations autochtones affirment leur leadership sur des territoires ancestraux. terres. Cinq nations autochtones ont été le fer de lance des efforts visant à établir Bears Ears, et le décret du président Obama créant le monument a explicitement donné à ces nations une voix officielle sur la manière dont le monument devait être géré. Ce système de leadership autochtone pourrait et devrait être un modèle pour d’autres parcs nationaux et forêts nationales. Entre-temps, les peuples autochtones créent des fiducies foncières autochtones innovantes dans les zones rurales et urbaines pour rapatrier les terres et accroître la souveraineté alimentaire, tandis que d’autres élaborent des accords de cogestion intégrée sur des terres privées pour mettre en œuvre des pratiques de brûlage traditionnelles. Par exemple, le Native American Land Conservancy, une fiducie foncière contrôlée par les autochtones dans les déserts du Colorado et de Mojave en Californie, travaille avec les tribus locales, les propriétaires fonciers, les agences fédérales et les organisations environnementales pour racheter, restaurer et gérer les terres ancestrales afin de les protéger. sites sacrés et renouveler le patrimoine culturel. Et les groupes autochtones du Canada au Pérou créent de nouveaux types de parcs tribaux et d’autres zones protégées par les autochtones.
Mais les 326 superficies administrées en tant que réserves indiennes, qui couvrent environ 56 millions d’acres, sont éclipsées par les plus de 800 millions d’acres de terres publiques fédérales à travers les États-Unis. Toutes ces terres publiques fédérales – chaque centimètre carré d’entre elles – sont des territoires ancestraux amérindiens, du parc national de Yosemite (domicile des Ahwahneechee exclus) au parc national des Glaciers (domicile des Pieds-Noirs) en passant par le parc national des Everglades (domicile des Miccosukee). Il est temps de réévaluer la gouvernance et la tutelle de ces terres et eaux et de rappeler collectivement que l’indigénéité est enracinée dans les principes de durabilité écologique.
Nous avons besoin d’une gestion intégrée aux pratiques culturelles basées sur la terre connues sous le nom de connaissances écologiques traditionnelles (TEK), les pratiques intergénérationnelles de protection des terres basées sur des paysages spécifiques et des modes de vie tribaux. Ces pratiques sont aussi diverses que les nations tribales de ce continent. Les gardiens du savoir traditionnel comprennent les pêcheurs de saumon Yurok dans le nord-ouest boisé, les agriculteurs des zones arides Pueblo dans le sud-ouest, les chasseurs d’orignaux Seneca dans le nord-est et les cueilleurs de maïs vert Muscogee dans le sud-est. Après avoir appris auprès de nombreux intendants des terres amérindiens de Californie, l’auteur euro-américain M. Kat Anderson a qualifié la relation des peuples autochtones avec la terre de « s’occuper de la nature ». Aujourd’hui, les écologistes comprennent que les perturbations à petite échelle des écosystèmes, telles que l’allumage saisonnier des incendies ou la taille des arbres et des roseaux, peuvent être des processus importants qui créent des mosaïques d’habitats, qui à leur tour produisent une biodiversité fertile et enrichissent les processus écosystémiques, tout en fournissant de la nourriture, des médicaments, des vêtements, et un abri. Certaines personnes qualifient désormais cette interaction intime entre l’entretien des terres par l’homme et la résilience des écosystèmes de « diversité bioculturelle » ou de « patrimoine bioculturel ». La plupart des peuples autochtones l’appelleraient simplement « s’occuper de toutes mes relations ».
Cette approche plus holistique de la gestion des terres devrait représenter le prochain paradigme du mouvement de conservation ; cela peut être un moyen d’aborder directement les problèmes d’injustice historique et environnementale. En raison des croyances racistes profondément ancrées et souvent inconscientes au sein du mouvement de conservation, la compréhension de la science autochtone sophistiquée consistant à travailler avec les processus naturels de manière réciproque a suscité peu d’intérêt. Les défenseurs de l’environnement ont contribué à la construction sociale de la nature sauvage, qui place la nature comme un lieu à part de l’humanité, et en a bénéficié économiquement. L’idée du mouvement conservationniste de protéger la nature principalement comme un espace de révélations personnelles et de loisirs pour les Blancs a été l’une des hypothèses non examinées du conservationnisme. C’est aussi un exemple de pensée binaire, puisqu’elle suppose que les humains sont soit des destructeurs de la nature (comme en témoignent les premiers colons et les « Indiens sauvages »), soit des protecteurs de la nature (transcendantalistes, environnementalistes et « Indiens écologiques » romancés). Pendant trop longtemps, on n’a pas compris une voie médiane ni reconnu que les peuples autochtones vivaient avec le monde naturel, l’utilisant avec un minimum de dommages et, dans de nombreux cas, améliorant la biodiversité de leurs terres d’origine.
Même s’il reste encore beaucoup à faire pour décoloniser le mouvement de conservation, les connaissances écologiques traditionnelles et les sciences autochtones basées sur le lieu reçoivent enfin une partie de la reconnaissance qu’elles méritent. De nombreux peuples autochtones sont disposés à partager leurs connaissances avec des écologistes et des gestionnaires de terres occidentaux, et des tentatives de collaboration ont montré comment les connaissances écologiques traditionnelles peuvent s’associer aux connaissances écologiques scientifiques pour mieux répondre aux problèmes environnementaux urgents comme le changement climatique et la conservation des bassins versants. Les gestionnaires des terres peuvent intégrer les leçons tirées des projets de restauration écoculturelle autochtones et rechercher des partenariats de cogestion avec des gestionnaires des incendies, des protecteurs de l’eau, des vanniers, des cueilleurs de graines et des chasseurs autochtones. Certains districts forestiers nationaux et autres terres publiques, par exemple, ont récemment commencé à expérimenter des pratiques amérindiennes de gestion des incendies.
Alors que les États-Unis sont conscients de leur passé colonial et des dommages causés par la dépossession des Amérindiens, nous devons réinventer nos méthodes de gestion des terres – pour le bien de la planète et de ses nombreux êtres vivants. Le mouvement de conservation et les agences gouvernementales peuvent se transformer en écoutant et en apprenant des peuples autochtones et, en retour, en leur offrant leur soutien. C’est ainsi qu’ensemble nous pouvons décoloniser nos relations avec la terre et l’eau. Nous devons honorer et respecter les connaissances environnementales et les modes de vie des peuples autochtones et, ce faisant, contribuer à restaurer les espèces totémiques clés et les processus culturels clés, de la médecine du sureau à la migration du saumon. Un tel honneur et un tel respect peuvent servir comme une sorte de médecine culturelle et nous permettre d’assumer notre responsabilité sacrée en tant que humbles membres de cette magnifique Terre.
Cet article est paru dans l’édition de janvier/février sous le titre « Il est temps d’indigéniser la conservation ».





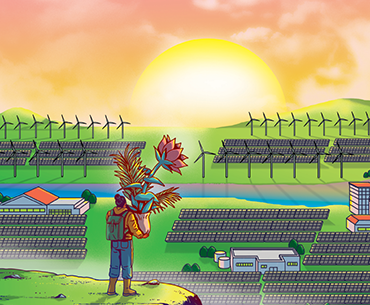
















0 réponse à “Il est temps d’autochtoniser les terres et de conserver l’eau”